AVIS CSF : logements neufs invendus, saisir les opportunités du marché en 2026
AVIS CSF : acheter dans le neuf, un investissement serein et durable en 2026
AVIS CSF : acheter moins cher avec le bail réel solidaire
AVIS CSF : pour faciliter la recherche de logement des agents du service public
AVIS CSF : pourquoi acheter plutôt que louer en 2026 ?
AVIS CSF : les avantages du mandat de vente pour les fonctionnaires
AVIS CSF : Coaching immobilier, la solution pratique et rapide pour mieux vendre en 2026
AVIS CSF : quel apport personnel pour votre crédit immobilier en 2026 ?
AVIS CSF : Meilleurtaux - le Guide du CSF sur le courtage, le crédit et l'assurance
AVIS CSF : emprunt immobilier fonctionnaire, le guide 2026 pour réussir votre projet
AVIS CSF : pourquoi investir dans l'immobilier neuf ?
AVIS CSF : investir dans l'immobilier neuf en 2026 - Les alternatives à la loi Pinel
AVIS CSF : l’histoire de la femme et du prêt en France
AVIS CSF : le taux d’usure en 2026, un levier clé pour les crédits immobiliers
AVIS CSF : quelles perspectives pour les prix de l'immobilier en 2026 ?
AVIS CSF : prêt personnel travaux, l'atout clé pour valoriser votre patrimoine avant 2026
AVIS CSF : le prêt à la consommation en 2025
AVIS CSF : prêt à la consommation, un levier pour la rénovation énergétique
AVIS CSF : le Prêt Personnel Fonctionnaire, un atout pour vos projets
AVIS CSF : comprendre les différences entre prêt affecté et prêt non affecté
AVIS CSF : le regroupement de crédits, un levier méconnu pour accéder à la propriété en 2026
AVIS CSF : regroupement de crédits, le "nettoyage" budgétaire pour bien commencer 2026
AVIS CSF : regrouper ses crédits pour réduire ses charges en 2025
AVIS CSF : le regroupement de crédits concerne-t-il aussi les fonctionnaires ?
AVIS CSF : quels sont les avantages du rachat de crédits pour les fonctionnaires en 2025?
AVIS CSF : l’histoire de la femme et du prêt en France
Avant 1965 : une femme mariée sans droits bancaires
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la femme mariée en France est considérée juridiquement comme une mineure, au même titre que les enfants. Ce statut prive les femmes mariées de leur capacité juridique, elles ne peuvent ni ouvrir un compte bancaire, ni gérer leur propre argent sans l’autorisation explicite de leur époux.
Des assouplissements apparaissent progressivement au fil des années, notamment pour les marchandes publiques, les veuves, divorcées ou célibataires, qui peuvent, elles, disposer librement de leur argent.
En 1881, un premier pas est franchi. Les femmes mariées peuvent ouvrir un livret de caisse d’épargne, à condition qu’il soit destiné à économiser pour les besoins du foyer.
En 1895, elles obtiennent le droit de retirer de l’argent de ce livret. Mais ces droits restent limités et la majorité des femmes étant mariées restent exclues de la pleine autonomie financière.
Vers l’émancipation : des lois encore incomplètes
En 1907, les femmes mariées peuvent enfin disposer de leur salaire, mais l’autorisation tacite du mari reste souvent exigée par les banques.
La loi de 1938 abolit l’incapacité juridique des femmes mariées : elles deviennent « majeures » et peuvent agir seules. Mais leur mari conserve le dernier mot sur des décisions clés comme le lieu de résidence ou le droit au travail.
En 1942-1943, face à la guerre, le régime de Vichy autorise temporairement les femmes à ouvrir un compte bancaire ménager pour faciliter les paiements. Une avancée significative, mais encore limitée et conjoncturelle.
1965 : la fin de la tutelle maritale et l’accès libre au crédit
Le 13 juillet 1965, une date historique.
Le général de Gaulle fait adopter une réforme du régime matrimonial qui change profondément la donne. La loi supprime enfin l’obligation d’obtenir l’autorisation du mari pour que les femmes puissent :
- Ouvrir un compte bancaire
- Travailler
- Signer des chèques
- Gérer les biens acquis avant ou pendant le mariage
Dès lors, toutes les femmes mariées ou non peuvent contracter un prêt bancaire à leur nom, exercer une activité professionnelle sans contrôle marital, et disposer de leurs ressources. C’est la fin d’un long combat entamé plus d’un siècle plus tôt.
La part des femmes au CSF
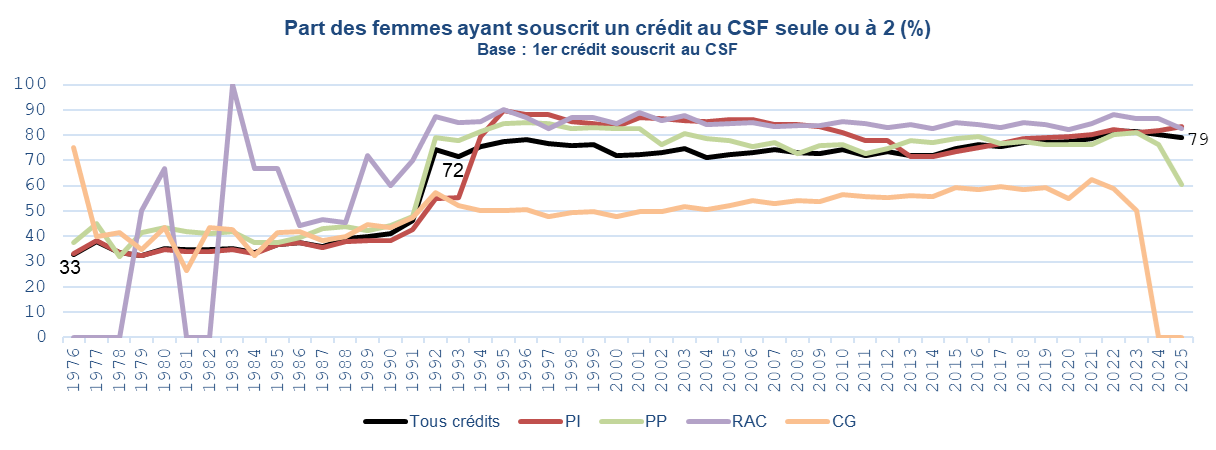
Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de la part des crédits souscrits au CSF par des femmes seules ou en couple depuis 1976. On y constate une nette progression à partir des années 1990, avec une part stable autour de 72 % en 1993 et 79 % en 2025. Autrement dit, près de 8 crédits sur 10 incluent aujourd’hui au moins une femme emprunteuse.
Parmi les emprunts souscrits en 2025, 79% ont au moins un emprunteur ou co-emprunteur femme dont :
- 45% sont un couple homme/femme
- 33% sont des femmes seules
- 1% sont un couple de femmes

Jusqu’au début des années 1990, les crédits sont majoritairement souscrits par des hommes seuls, les femmes seules et les couples étant beaucoup moins représentés.
À partir de 1992, la part des couples homme/femme augmente fortement et devient la forme dominante d’emprunt. Elle oscille ensuite autour de 45 % sur les décennies suivantes, reflétant une dynamique plus égalitaire et partagée dans les démarches de crédit.
La part des femmes seules reste relativement constante, autour de 35 %, tandis que celle des hommes seuls diminue progressivement avec le temps.
Cette évolution témoigne d’une tendance claire : les femmes sont aujourd’hui présentes dans la majorité des dossiers de crédit, que ce soit seules ou en couple.
Dernière mise à jour : 28/07/2025




